


A
propos de la traduction du Notre Père
un article de Monseigneur Grégoire
Lors
de mon récent pèlerinage à Jérusalem j’ai
visité sur le Mont des Oliviers la grotte dite du « Notre
Père » et le sanctuaire dédié à la
Prière du Seigneur. Dans la galerie qui entoure cette église
on trouve, en mosaïque la traduction du « Pater » dans
toutes les langues du monde (ou presque). J’ai été
frappé par la multitude des traductions de cette prière
et par la pauvreté de la traduction française par rapport
à la plupart des autres langues… Déjà en
octobre 2005 un article a été publié sur un site
Internet orthodoxe sur ce sujet. On trouvera dans l’article qui
suit les remarques et études que j’avais publiées
en 1990 dans mon cours sur l’Histoire de la Liturgie. ()
1. La structure du Notre Père
«
Nul n’ignore l’importance de cette
prière que Jésus lui-même donne comme modèle
de la prière liturgique. Il faut faire ici une remarque valable
pour l’ensemble de la liturgie chrétienne : la spiritualité
chrétienne se manifeste sous deux formes de prières :
l’une, celle de l’esprit, est informulée, et c’est
celle du Christ lui-même, quand il se retire, solitaire, sur la
montagne. C’est celle aussi qu’il recommande et que Dieu
récompensera car « Il voit les choses cachées
», et il ne faut jamais perdre de vue la nécessité
de cette prière intérieure informulée — parfois
un simple soupir... L’autre prière, qui est prononcée,
s’incarne dans un son « quand deux ou trois sont réunis
au nom de Dieu ». Dès lors, il y a « liturgie
» c’est-à-dire « œuvre commune »
à laquelle tous les principes de la liturgie viennent s’appliquer,
principes qui font appel à une démarche artistique, car
le fait même de formuler une pensée en mots est un art
par lui-même. La prière liturgique est donc bien un art
dont le Notre Père nous donne un exemple d’un raffinement
incomparable, et qui mérite une étude approfondie. »
(Maxime Kovalevsky)
Le texte du Notre Père nous est parvenu sous deux formes, une
recension longue dans Mt 6*9-13 et une plus courte dans Lc 11*1-4. L’usage
liturgique n’emploie que la recension longue de Matthieu ; de
plus nous connaissons au moins deux manuscrits anciens qui ajoutent
à la fin du texte une doxologie : «car c’est
à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et
la gloire, aux siècles des siècles. Amen».
Depuis le début du 20ème siècle cette doxologie
a été supprimée des évangiles traduits en
français ; il y eut à son sujet une longue polémique
; finalement, grâce aux progrès des connaissances en matière
d’usages liturgiques juifs aux temps évangéliques,
les exégètes sont presque unanimes à penser que
le Christ a bien prononcé cette doxologie, car c’est une
formule quasi-obligatoire pour finir une prière juive.
Le texte original du Notre Père est en grec, car il ne nous a
pas été conservé en hébreu, ni en araméen.
Le Notre Père a bien existé en hébreu. Le texte
hébreu actuel est une re-traduction, une «rétroversion»
à partir du texte grec de saint Matthieu.
En grec, dans l’Evangile de saint Matthieu il se présente
en douze formules (ou récitatifs) distribuées en deux
strophes de six formules chacune, [en hébreu : 36 mots (4 fois
9 mots)]
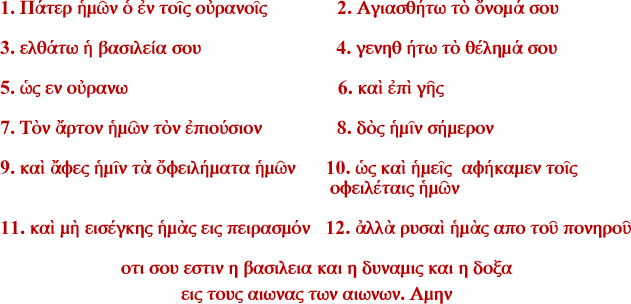
En voici un décalque français (
a ) :
| 1 Père à nous qui [es] aux cieux | 2 sanctifié [soit] le Nom de Toi |
| 3 Vienne le règne de Toi | 4 accompli [soit] le vouloir de Toi |
| 5 comme au ciel | 6 ainsi sur terre. |
| 7 Le pain de nous sur-essentiel | 8 donne-nous aujourd’hui |
| 9 remets les dettes de nous | 10 comme nous avons remis aux débiteurs de nous |
| 11 et nous laisse pas entrer dans la tentation | 12 mais délivre nous du malin. |
car
c’est à Toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen. |
|
Un
simple coup d’œil permet de découvrir la construction
:
le premier récitatif répète la formule «
de Toi » ; appelons-le
« dans le ciel de Toi
» ; il est en rapport direct avec Dieu et le ciel ; il se termine
par le mot terre qui est l’agrafe permettant de passer au deuxième
récitatif.
Celui-ci pourrait s’appeler : « sur
la terre de nous » car il est plus en rapport
avec l’homme et la terre.
Il faut aussi remarquer que chaque récitatif commence par une
expression parallèle :
Notre Père ……… notre pain…
Cette magnifique construction s’est perdue dans nos traductions
modernes (elle subsiste toutefois en latin)
« mais cette prière reste «
divine » parce qu’elle a été dictée
par Dieu lui-même : elle possède une force réelle
et renferme à elle seule tous les éléments de la
prière liturgique : communion, sacrifice, mémorial et
action de grâce. » (Maxime Kovalevsky)
De ces formules qui paraissent si nouvelles, aucune n’est originale
(on a pourtant l’impression que le Christ les a composées
à l’intention de ses disciples) ; elles existent toutes
dans l’Ancien Testament. Mais ici elles sont agencées d’une
manière nouvelle, avec un ordre nouveau, une hiérarchie
nouvelle, une initiation, une démarche particulière où
le ciel sert de modèle à la terre.
On trouve dans les Targoums (traductions araméennes de la Bible)
toutes les formules présentes.
Exemples :
Notre Père qui es aux cieux :
– Targoum d’Esther : Votre Père qui est aux cieux…
– Targoum de Jérusalem : leur père qui est aux cieux…
Que
ton Nom soit sanctifié :
– Targoum d’Isaïe : ils sanctifieront Mon Nom et Je
sanctifierai Mon Nom.
Que
Ton règne arrive :
– plusieurs autres targoumim : que vienne le règne du Messie.
Que
ta Volonté soit faite :
– Targoum du psaume 40 : fera-t-Il sa volonté ?
Pour
ce qui concerne le pain des cieux ou pain du « Jour-qui-est-venant
» ( b ), cette
expression se trouve telle quelle dans plusieurs midrash, c’est-à-dire
des commentaires rabbiniques de l’époque évangélique.
Ainsi les apôtres en entendant ce texte n’ont sans doute
pas eu l’impression de quelque chose de nouveau, ils avaient déjà
entendu toutes ces phrases, elles leur semblaient familières.
Cela donne au Notre Père une dimension différente, historique,
quasi cosmique et nous révèle cette immense architecture
à laquelle le Christ pensait sans doute en le récitant.
Cela permet de comprendre que la liturgie fonctionne de cette manière,
par des sortes d’échos ou d’allusions.
2. Quelques difficultés de traduction : ( c )
Phrases
1 & 2
Ces deux premières phrases ne posent aucun problème notable.
Phrase
3
Cette troisième phrase « Que Ton règne vienne
(ou arrive) » est plus délicate.
Comment traduire les mots hébreux « Malkhouta » ou
grec « Vassilia » qui en français signifient à
la fois « royaume », « règne » et «
royauté » ?
Nous avons donc trois mots en français pour en traduire un seul
de l’hébreu ou du grec.
On peut d’emblée écarter « royauté
» car « vienne Ta royauté » n’aurait
pas grand sens, mais « règne et royaume » sont à
étudier. « Royaume » a un sens plus géographique,
plus spatio-temporel ; «règne» est une notion un
peu plus abstraite, plus morale. Le mot prononcé par le Christ
avait les deux sens à la fois.
Le verbe « venir » traduit mieux le verbe grec « ![]() :
elthato » que le verbe « arriver ».
:
elthato » que le verbe « arriver ».
Phrases
5 & 6
« Comme au ciel, ainsi sur terre »
Si l’on retourne la phrase – comme c’est toujours
le cas en français – en disant : « sur la terre comme
au ciel », on détruit la structure voulue par le Compositeur,
en l’occurrence le Rabbi Yeshoua de Nazareth, qui a mis «
terre » à la fin et « ciel » au début
pour raccrocher le deuxième récitatif. De plus, il est
évident que le ciel passe avant la terre, et lui sert de modèle.
(Le français est la seule langue au monde à avoir fait
cet inutile retournement !)
Cette phrase, d’ailleurs, semble ne pas être liée
exclusivement à « Que ta Volonté soit faite »
mais à tout ce qui précède.
Phrase
7 « Notre pain substantiel »
Grave question quasi insoluble ! ( d )
Nous disons : « donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel,
» quelques-uns ont dit depuis le 17ème siècle :
« Notre pain quotidien » et le grec dit – littéralement
: « le pain, le nôtre, epiousion » mot qui fait difficulté.
Ce
mot a deux sens possibles :
– le sens ordinaire, celui de la langue courante, en est : «
nécessaire, indispensable », c’est pourquoi on a
pris ce sens dérivé : « de chaque jour. »
C’est le sens que le grec actuel donne à ce mot, mais à
l’époque du Christ il avait probablement un autre sens.
– un sens obtenu en décomposant le mot : on trouve le préfixe
« epi » qui est traduit en latin par «super»
(au-dessus) et «ousios» littéralement « l’essence
», dérivé du verbe être. On peut donc traduire
: « qui est au-dessus de l’être ».
L’évêque Jean de Saint-Denis avait opté pour
« substantiel », qui est en fait « super-substantiel
» ou «super-essentiel». Il est probable que le Christ
a prononcé un mot hébreu qui avait ces deux sens. (Les
jeux de mots sont fréquents dans la Bible.)
Le Père Carmignac est un des partisans de ce double sens que
le Christ a dû utiliser : c’est en même temps un «
pain nécessaire » et un « pain du jour qui vient
» (en hébreu : hayom haba). Nous demandons dès aujourd’hui
ce pain du lendemain et il y a sans doute là allusion au Jour
avec un grand "J" ou à l’Eucharistie.
L’évêque Jean nous précise bien que le seul
pain essentiel pour l’homme c’est l’Eucharistie, le
Corps même du Verbe de Dieu.
Phrases
9 & 10 « Remets-nous nos dettes »...
Dans nos traductions nous avons : «remets-nous nos dettes comme
nous remettons à nos débiteurs.» Maxime Kovalevsky
insistait sur le fait qu’il n’y avait pas simultanéité,
mais que notre remise précédait celle de Dieu : «
Si nous ne savons pas remettre aux autres, nous
ne serons pas capables de recevoir la remise ». Il faut
donc bien préciser dans le texte que « nous avons remis
» ; cette rémission se passe avant la demande ; avant de
demander au Père de nous remettre nos nombreuses dettes il est
indispensable que nous remettions les dettes à nos débiteurs.
Certains puristes, sous prétexte que le verbe « remettre
» exige un complément, ont voulu dire «Remets-nous
nos dettes comme nous les remettons à nos débiteur»
! Ce « les » est si ambigu qu’il vaut mieux le supprimer.
Maxime Kovalevsky faisait remarquer que cette tournure pouvait être
comprise comme : « Remets-nous nos dettes comme nous remettons
nos dettes à nos débiteurs ! » Ce qui est absurde
! D’ailleurs le verbe remettre en français peut s’employer
sans complément tel que dans l’expression : « je
vous remets... vous êtes untel ! » c’est-à-dire
« je me souviens de vous... je vous reconnais. »
Il vaut mieux passer sous silence la traduction « pardonne-nous
nos offenses… » qui est malheureusement fort répandue
et qui, non seulement, n’a pas le moindre rapport avec le texte
original, mais est quasiment blasphématoire… Dieu est au-delà
de l’offense ! Il est plus que regrettable que cette formule ait
été choisie pour la traduction «œcuménique
de la Bible en français».
Phrase
11 « Ne nous soumets pas à l’épreuve... »
Le premier problème est le suivant :
Dieu peut-Il soumettre quiconque à la tentation ou même
à l’épreuve? Encore le mot « épreuve
» peut-il être compris dans le sens où Saint Paul
l’emploie, c’est-à-dire quelque chose de difficile
mais que nous avons la force de supporter, mais le mot « tentation
» ...
Le texte dit littéralement : « Fais pas entrer nous dans
la tentation ».
Depuis le début du « Notre Père » remarquons
bien qu’il n’y a que des phrases positives, pourquoi tout
à coup une phrase négative « ne nous soumets pas
» ?
Voici
une explication possible, et même probable :
Il faut tout d’abord savoir que les langues sémitiques
possèdent trois formes de conjugaison :
– la forme normale, le mode direct, où par exemple le verbe
« tuer » a le sens
de tuer.
– la forme intensive où le verbe « tuer
» prend le sens de « massacrer
» (tuer beaucoup).
– la forme causative qui donne pour notre exemple : « faire
tuer ». ( e )
Si le Christ a utilisé cette forme causative du verbe «
entrer » dans sa tournure négative, cela donnerait : «
fais que nous n’entrions pas... » et non : « ne fais
pas que nous entrions... » Les traductions ont mal placé
la négation, elle doit être, liée au verbe «
entrer » ou « succomber » ou «être soumis»
mais en aucun cas au verbe « faire ».
La bonne traduction deviendrait donc : « Fais
que nous n’entrions pas dans la tentation. »
Deuxième
problème :
Dans nos traductions habituelles on trouve « Ne nous soumet pas
à la tentation », mais en grec c’est la préposition
« eis » [![]() ]
qui est utilisée et qui se traduit par dans
(à l’intérieur) ; le latin également emploie
bien in qui veut dire dans.
Même la formule « ... entrer en
tentation » n’a pas tout à fait le même sens.
Entrer dans la tentation a un sens bien précis : c’est
accepter cette tentation.
]
qui est utilisée et qui se traduit par dans
(à l’intérieur) ; le latin également emploie
bien in qui veut dire dans.
Même la formule « ... entrer en
tentation » n’a pas tout à fait le même sens.
Entrer dans la tentation a un sens bien précis : c’est
accepter cette tentation.
Le Père Carmignac insiste beaucoup sur ce détail car,
dit-il, on demande à Dieu de ne pas nous laisser venir volontairement
dans la tentation, c’est l’idée de consentement qui
domine et que l’on oublie, hélas, de traduire.
On devrait dire : « Fais que nous ne consentions pas à
la tentation. »
La meilleure traduction en français, qui préserve la forme
positive et l’idée de consentement serait : «Garde-nous
d’entrer dans (ou de consentir à) la tentation».
Phrase
12 « Mais délivre-nous du malin »
Cette phrase est le complément de la précédente.
Il y a un balancement entre les deux phrases, une véritable dialectique
qui pourrait se traduire par : « Ne nous laisse pas entrer dans
la tentation SANS nous délivrer du malin ! » On ne peut
en aucun cas séparer les deux propositions.
Le verbe grec « rysai » [![]() ]
se traduit mieux par « écarte-nous
» que par « délivre-nous » ou encore
comme en hébreu par « arrache-nous
».
]
se traduit mieux par « écarte-nous
» que par « délivre-nous » ou encore
comme en hébreu par « arrache-nous
».
Le malin ( en grec : poneros) est employé dans l’original
au génitif singulier, forme commune au masculin et au neutre
; il est donc difficile de savoir si l’on doit traduire «
celui qui est malin » (masculin) ou « ce qui est malin »
(neutre). Le mot signifie ordinairement : méchant, mauvais, et
même criminel ou voyou.
La tradition de l’Eglise Orthodoxe traduit « le malin »,
version plus concrète et plus précise que « le mal
», version adoptée par l’Eglise Romaine à
la suite de saint Jérôme (sed
libera nos a malo). ( f )
On
comprendra, je le souhaite, à la lecture de ce qui précéde,
l’urgence d’une traduction correcte, fidèle, intelligente,
de ce texte capital en français. Il est temps que les orthodoxes
francophones, qui se veulent les chrétiens de la « juste
glorification » aient enfin le courage de cette indispensable
réforme …
Pour ce qui concerne notre Eglise Orthodoxe des Gaules, je propose la
traduction suivante, très légèrement différente
de celle que nous utilisons en ce moment :
Notre
Père qui es aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié
Que ton Règne arrive, (var.
Que ton Règne vienne)
Que ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel (var. comme au ciel ainsi sur terre)
Donne-nous
aujourd’hui notre pain substantiel
Et remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs,
Garde-nous de consentir à la tentation
mais délivre-nous du malin.
car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire aux siècles des siècles. Amen ( g )
Pour information voici les textes du Notre Père en anglais et
en allemand:
en Anglais (Bible Darby) ( Mt 6 : 9-15)
9 Our Father who art in the heavens, let thy name be sanctified,
10. let thy kingdom come, let thy will be done
as in heaven so upon the earth;
11. give us to-day our needed bread,
12. and forgive us our debts, as we also forgive our debtors,
13. and lead us not into temptation, but save us from evil.
en
Allemand (Schlachter 1951) ( Mt 6 : 9-15)
9. Vater Unser, der du bist im Himmel ! Geheiligt werde dein Name.
10. Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe
wie im Himmel, also auch auf Erden.
11. unser tägliches Brot Gib uns heute.
12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!
Amen.
![]() ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________![]()
> a. un décalque n’est
pas une traduction ; le décalque respecte l’ordre et le
nombre des mots du texte original sans se soucier de la syntaxe.
> b. un des sens du mot grec «
epiousion » [![]() ]
]
> c. la meilleure étude sur ce sujet se trouve
dans les travaux du Père Jean Carmignac (décédé
en 1988) publiés dans un ouvrage capital Recherches sur le Notre
Père, Letouzey et Ané. 1969
> d. déjà Origène
(de oratione XXVII, 7-13), Saint Jérôme (com. in Titum
2, 14) et Saint Jean Cassien (Conf. IX, 21) ont émis les hypothèses
que nous développons ici, ils ont été suivi par
de nombreux autres Pères : Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise...
> e. pour les hébraïsants : forme Hiphil
> f. d’une façon générale
les traductions françaises classiques sont faites sur le texte
latin et non sur l’original grec.
> g. C’est encore loin du texte idéal
mais, à mon sens, un notable progrès. Ce texte idéal
- mais difficile à mettre en œuvre - serait par exemple
:
Notre Père qui
es aux cieux,
sanctifié soit ton Nom,
vienne ton Règne,
accompli soit ton Vouloir
comme au ciel ainsi sur terre.
Notre pain substantiel,
donne-le nous aujourd’hui,
et remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs
garde de consentir à la tentation mais délivre-nous du
malin.
(Traduction inspirée par les travaux de Marcel Jousse)
![]() ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________![]()
Commentaire d'une lectrice
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les recherches sur la traductions française du Notre Père. Avec un recours au texte slavon et grec, j'ai également tenté une traduction, très littérale que voici :
Notre
Père, qui est dans les cieux, que soit sanctifié ton nom.
Que vienne ton royaume.
Que soit ta volonté, comme dans le ciel et sur la terre.
Notre pain substantiel donne-nous aujourd’hui.
Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi avons remis à nos
débiteurs.
Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation,
Mais délivre-nous du malin.
Peut-être
peut-elle contribuer à ce travail. Personnellement, je préfère
"royaume" à "règne", car tous les
autres passages de l'évangile traduisent "royaume"
: mon royaume n'est pas de ce monde, dans ton royaume, souviens-toi
de moi...
enfin, pour la tentation, "ne nous laisse pas entrer" me semble
plus clair en français.
Andrea
Commentaire extrait d'un essai sur l'angéologie
Aujourd'hui, si Satan ne fait pas partie de la profession de foi, le Credo des catholiques, il apparaît en revanche dans le Pater, le « Notre Père », la prière de tous les chrétiens, à la dernière phrase : Et ne nos inducas in tentationem, sed libéra nos a Malo, traduite de manière étonnante par « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal », alors qu'elle signifie : « Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du Malin » puisque, dixit le catéchisme lui-même (1) : « Dans cette demande, le Mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le Mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu »... Le Mal affiche un air plus présentable, plus discret et plus rationne] que le Malin, ce vieux diable velu dont la représentation dantesque : gigantesque, tricéphale, avec deux grandes «ailes sans plumes ressemblant à celles de la chauve-souris », qui « pleure par six yeux sur trois mentons où gouttent ses pleurs et sa sanglante bave (2) » a fini par disparaître des églises après les directives de bon goût émises par le concile de Trente en 1563.
Alix
de Saint-André
in Archives des anges Folio Gallimard
1. Catéchisme de l'Église catholique, par. 2851, PIon/Mame.
2. Dante, La Divine Comédie, « L'Enfer », chant XXXIV.
![]() 1. cours faisant partie du cursus de l' Ecole de théologie Saint-Hilaire-de-Poitiers
1. cours faisant partie du cursus de l' Ecole de théologie Saint-Hilaire-de-Poitiers
![]() 2. Notre Père en araméen
2. Notre Père en araméen
![]() Commentaire du Notre Père
Commentaire du Notre Père